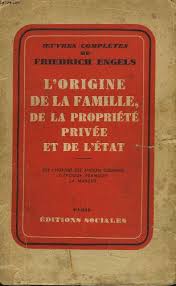
Marx décède en mars 1883 et Engels s’attèle, immédiatement après ce triste événement, à l’exécution de ce legs moral. Contrairement au Capital de Marx, qui partait de l’étude d’un phénomène plus contemporain et forcément mieux documenté, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État est terriblement marquée par le niveau des connaissances anthropologiques de l’époque. Il est par exemple significatif qu’Engels dénonce la société de classes « au long des 2 500 ans de son existence », alors qu’on sait aujourd’hui - après avoir pris connaissance du livre de Scott intitulé Homo Domesticus : Une histoire profonde des premiers État[2]s - que les premiers regroupements humains où surgit le phénomène étatique remonte à au moins six millénaires. À l’époque où écrit Engels, l’échelle des temps, dans l’histoire de la Terre, comme dans celle des sociétés humaines, n’est pas du tout celle qui est admise aujourd’hui. La manière dont Engels retrace l’histoire des sociétés humaines est marquée par l’échelle des temps géologiques admise au XIXe siècle et aussi par les limites des connaissances concernant la préhistoire de l’humanité comme l’histoire des premières civilisations. Il est donc hors de question de lui chercher noise sur ces sujets. Ceci étant dit, le 135e anniversaire de la parution du livre de Engels est une trop belle occasion pour ne pas effectuer un retour-critique sur la conception marxiste de l’État.
Dans les lignes qui suivent, nous entendons dans un premier temps exposer les origines et les perspectives d’avenir de l’État selon Marx et Engels. Par la suite nous présenterons certaines thèses qu’ils ont développées au sujet de l’État et du pouvoir politique. Nous examinerons les liens qui sont établis par cette problématique entre le politique et la société et enfin l’État et les classes sociales
Genèse de l’État
De Marx et d’Engels, c’est manifestement ce dernier qui a le plus contribué à établir une perspective anthropologique marxiste de l’État. Chez Engels, l’État et le pouvoir politique apparaissent quand la société atteint un stade de développement qui nous met en présence de groupes sociaux opposés : « L’État n’existe pas de toute éternité. Il y a des sociétés qui se sont tirées d’affaire sans lui, qui n’avaient aucune idée de l’État et du pouvoir d’État. À un certain stade de développement, qui était nécessairement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l’État une nécessité. » (Engels, 1974, p.159).
Cet État, ou ce pouvoir d’État, de premier niveau dirons-nous est un organisme dont l’objectif est la défense des « intérêts communs » : « L’État s’offre à nous comme la première puissance idéologique s’exerçant sur l’homme. La société se crée un organisme en vue de la défense de ses intérêts communs, contre les attaques intérieures et extérieures. Cet organisme est le pouvoir d’État. A peine né, il se rend indépendant de la société, et cela d’autant plus qu’il devient l’organisme d’une certaine classe, qu’il fait prévaloir directement la domination de cette classe. » (Engels, 1888).
Le caractère de classe de l’État (État de deuxième niveau) ne coïncide pas avec l’émergence de l’État. Le caractère de classe de l’État n’est pas compatible avec l’expression originelle de ce pouvoir de la société (l’État chargé de la défense des « intérêts communs »). Chez Marx et Engels, l’État de classe voit le jour un peu plus tard : « En quoi consistait jusqu’ici (référence à la période historique se rendant jusqu’à la Commune de Paris Y.P.) le caractère essentiel de l’État ? La société avait créé, par simple division du travail à l’origine, ses organes propres pour veiller à ses intérêts communs. Mais avec le temps, ces organes dont le sommet était le pouvoir d’État s’étaient transformés en suivant leurs propres intérêts particuliers de serviteurs de la société en maître de celle-ci » (Engels in Marx 1968, p. 23)
L’État de classe chez Marx et Engels est donc l’expression, la réalisation d’un processus politique de domination. L’État originant des contradictions internes de la société, renvoie à deux processus distincts. Le premier, celui qui aboutit à la division sociale du travail. Le deuxième, la division sociale du pouvoir. Deux voies différentes par lesquelles sont issues les rapports de domination politique. C’est du moins ce que laisse sous-entendre Engels lorsqu’il écrit : « Mais à côté de cette formation de classes (la formation de l’État et donc de la classe qui pourvoit aux affaires communes de la société Y.P.), il s’en déroulait encore une autre. La division naturelle du travail à l’intérieur de la famille agricole a permis à un certain niveau de bien-être, d’introduire une ou plusieurs forces de travail étrangères. » (Engels, 1973, p. 208)
Le processus de formation de l’État de classe résulte donc de la rencontre de deux processus sociaux. La dynamique qui résulte de la division sociale du travail, mais aussi de la dynamique issue du pouvoir politique lui-même. Avant donc l’avènement de l’État de classe, l’État ne se distingue pas de la société, et les personnes qui occupent des fonctions politiques n’exercent aucune fonction de domination. Plus tard, la fonction de domination politique caractérisera l’État et le pouvoir d’État.
Selon les prévisions prophétiques d’Engels, l’avenir s’annonce plutôt sombre pour l’État de classe. Comme l’écrit Engels : « Nous nous rapprochons maintenant à pas rapides d’un stade de développement dans lequel l’existence de ces classes a non seulement cessé d’être une nécessité mais devient un obstacle positif à la reproduction. Les classes tomberont aussi inévitablement qu’elles ont surgi autrefois. L’État tombe inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d’une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de 1’État là où sera dorénavant sa place ; au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze ». (Engels. 1974)
L’État est donc appelé à disparaître, il cesse d’exister pour « devenir le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu. Dès qu’il n’y a plus de classe sociale à tenir dans l’opposition (...) il n’y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un État (...). L’intervention du pouvoir d’État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l’autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses." (Engels, 1974)
Selon cette vision évolutionniste, l’avenir de l’État se retrouve au Musée et le pouvoir politique est appelé à perdre toute raison d’être. L’avenir se définit à l’intérieur de paramètres antérieurs à la division de la société en classe. On conviendra qu’une telle analyse présente manifestement un caractère réducteur. Malgré cet excès d’optimisme ou nonobstant cette navrante divagation au sujet de l’avenir de l’État, Marx et Engels nous ont laissé d’autres perspectives théoriques au sujet de l’État de classe ou l’État bourgeois.
L’État : un instrument de la bourgeoisie
La perspective théorique la plus connue de Marx et d’Engels au sujet de l’État le présente comme 1’instrument de la classe dominante. « L’État est la forme d’organisation que se donne la bourgeoisie. » (Marx et Engels, 1977, p.129). L’État de classe est donc celui de la classe dominante économiquement : « L’État étant donc la forme par laquelle les individus d’une classe économiquement dominante font valoir leurs intérêts communs. » (Marx et Engels, 1977) ce qui lui permet donc de transformer sa primauté économique en direction politique. Car selon Engels, l’État est : « L’État de la classe la plus puissante de celle qui domine au point de vue économique et qui grâce à lui devient aussi classe politiquement dominante. » (Engels, 1974).
Le pouvoir politique a tôt fait de devenir l’instrument des possédants. Les individus qui exercent le pouvoir politique font figure dans cette perspective non pas de serviteurs comme c’était le cas avant l’État de classe, mais bien plutôt d’exécutant au service de la classe possédante. « À peine né, il se rend indépendant de la société, et cela d’autant plus qu’il devient l’organisme d’une certaine classe, qu’il fait prévaloir directement la domination de cette classe. » (K. Marx, 1975) « Au fur et à mesure que l’industrie moderne développait, élargissait, intensifiait l’antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d’État, prenait de plus en plus le caractère d’un pouvoir public organisé aux fins d’asservissement social, d’un appareil de domination d’une classe. » (K. Marx. 1968, p.60) « La bourgeoisie depuis l’établissement de la grande industrie et du marché mondial s’est finalement emparée de la souveraineté politique exclusive dans l’État représentatif moderne, le gouvernement moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la bourgeoisie toute entière. » (Marx et Engels. 1975, p. 33).
Il ne saurait subsister de doute quant à la nature de l’État moderne. Il s’agit pour Marx et Engels d’un État de classe. État de la classe la plus puissante économiquement, à savoir la bourgeoisie. L’État moderne se confond avec les intérêts de la classe dominante économiquement, à ce titre il s’agit donc d’un État bourgeois dont les appareils sont non seulement au service de la bourgeoisie, mais aussi contrôlés par la classe dominante.
L’État comme composante de la superstructure
À cette conception de l’État instrument dévoué tout entier aux intérêts de la bourgeoisie, vient se greffer une autre représentation issue de la célèbre topique sociale esquissée par Marx dans la préface à la contribution à la critique de l’économie politique : « L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s’élève une superstructure juridique et politique (...). » (Marx, Karl. 1975, p.5) ou encore : « C’est toujours dans le rapport immédiat entre le propriétaire des moyens de production et le producteur direct (...) qu’il faut chercher le secret le plus profond ; le fondement caché de tout l’édifice social et par conséquent de la forme politique qui prend le rapport de souveraineté et de dépendance, bref la base de la forme spécifique que revêt l’État à une période donnée. » (K.Marx. Le capital, Livre 3, Tome III p. 172)
S’établit donc entre le politique et l’économique un rapport de causalité, l’instance politique découle des divisions qu’on retrouve au niveau de la division sociale du travail, donc du niveau économique.
Fonctions de 1’État
Cet État de classe prend en charge la société toute entière, « L’État enserre, contôle, réglemente, surveille et tient en tutelle la société civile", et comme "la machine d’État s’est si bien renforcée en face de la société bourgeoise" (...) "l’État semble être devenu complètement indépendant de la société. » (K. Marx, 1976). L’État est donc aussi posé à titre d’acteur social central, acteur qui dispose d’une autonomie réelle qui confine presque à l’indépendance face à la société. L’État de classe gère la société, et par ses règlements il la produit.
L’État en tant que facteur de cohésion sociale
Ce pouvoir qui gère et produit la société, veille au maintien de la cohésion sociale. En tant qu’instigateur d’ordre il doit viser à limiter et atténuer les luttes inévitables en raison des antagonismes de classes.
À ce sujet Engels écrira : « L’État n’est donc pas un pouvoir imposé du dehors de la société, il n’est pas davantage « la réalité de l’idée morale », « l’image de la réalité de la raison » comme le prétend Hegel. Il est plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement : il est l’aveu que cette société s’empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s’étant scindée en opposition inconciliables qu’elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonismes, les classes aux intérêts opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s’impose d’un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de « l’ordre » ; et ce pouvoir, né de la société, mais qui, se place au-dessus d’elle et lui devient de plus en plus étranger, c’est l’État. » (Engels. 1974 p.178)
Ce rôle de médiateur entre les classes, que jouerait l’État permettrait à la fois d’assurer la domination politique de la bourgeoisie, tout en créant les conditions propices à la reproduction du mode de production capitaliste. L’État est donc aussi une organisation, qui à travers ses institutions, maintient le pouvoir d’une classe sur l’ensemble des classes sociales. C’est du moins ce que dit Engels : « L’État moderne n’est à son tour que l’organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre les empiétements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. » (Engels. 1973, p.315)
L’État en tant que pouvoir appareillé
L’État en tant que forme particulière du pouvoir politique, propre à la domination politique de la bourgeoisie, est présenté chez Marx comme une machine gouvernementale : « Par État on entend la machine gouvernementale, autrement dit, l’État en tant qu’il forme par la suite de la division du travail un organisme spécial de la société » (K. Marx. Critique du programme de Gotha. La pléiade p. 1430) qui dispose d’un certain nombre d’institutions : « Le pouvoir centralisé de l’État avec ses organes partout présents, armée permanente, police, bureaucratie, clergé, magistrature, organes façonnées selon un plan de décision systématique et hiérarchique du travail date de l’époque de la monarchie absolue où il servit à la société bourgeoise naissante d’arme puissante contre le féodalisme. » (K. Marx. 1968 p.60)
Ce pouvoir centralisé se constitue en pouvoir public et bureaucratique, il se sépare de la société pour recouvrir l’ensemble du corps social de la société : « Au fur et à mesure que le progrès de l’industrie développait, élargissait, intensifiait l’antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d’État prenait de plus en plus le caractère d’un pouvoir public organisé aux fins d’asservissement social, d’un appareil de domination. » (K. Marx. 1968, p.60). « Ce pouvoir exécutif avec son immense organisation bureaucratique et militaire, avec son mécanisme étatique complexe et artificiel, son armée de fonctionnaires d’un demi-million d’hommes et son autre armée de cinq cent mille soldats, effroyable corps parasitaire qui recouvre comme d’une membrane le corps de la société française et en bouche toutes les pores, se constitue à l’époque de la monarchie absolue, au déclin de la féodalité, qu’il aida à renverser. Les privilèges seigneuriaux des grands propriétaires fonciers et des villes se transformèrent en autant d’attributs d’un pouvoir d’État, les dignitaires féodaux en fonctionnaires, appointés, et la carte bigarrée des droits souverains médiévaux contradictoires devinrent le plan bien rempli d’un pouvoir d’État dont le travail est divisé et centralisé comme une usine. » (K. Marx. 1976, pp. 124-125)
Ainsi donc, la mise en place d’une force intégrée commandée par la division de la société en classes donne naissance à une force publique répressive sous le contrôle de 1’État (armée, police et autres institutions répressives). À ces institutions répressives s’ajoutent les institutions administratives (fonctionnaires).
État et domination politique
L’État de classe constitue un redoutable moyen pour la classe économiquement dominante en vue d’exploiter et de dominer politiquement la classe ouvrière. "Comme l’État est né en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est dans la règle, l’État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui grâce à lui devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée". (F. Engels. 1974 p. 180)
Autonomie et indépendance de l’État
Toutefois face aux classes en lutte, il arrive que la domination s’affine. L’État, face aux classes en lutte, dispose d’une certaine autonomie. Comme le souligne Engels à cet égard : « Exceptionnellement il se présente pourtant des périodes où les classes en lutte sont si près de s’équilibrer que le pouvoir d’État, comme pseudo-médiateur, garde une certaine indépendance vis-à-vis l’une de l’autre. » (Engels, 1974 p. 180)
Pour conclure au sujet de l’analyse marxiste de l’État et de l’apport d’Engels sur l’origine du phénomène étatique
L’oeuvre de Marx et d’Engels fourmille de remarques et de propositions au sujet de l’État et du pouvoir politique. Nos deux auteurs y vont même d’une proposition prophétique quant au sort qui sera réservé à l’État dans une société future qui, faut-il le rappeler, n’a pas encore vu le jour. Malgré leurs nombreux écrits sur le politique, nous pouvons avancer que nous sommes loin d’être en présence d’une théorie achevée de 1’État ou d’une théorie systématique du pouvoir politique. De la lecture des écrits de Marx et d’Engels sur le politique, on retient l’impression qu’ils ont éprouvé de nombreuses difficultés à produire une problématique cohérente rendant compte, de façon satisfaisante de la logique des rapports qui se nouent entre l’État et la société, et l’État et les classes sociales. Il en va de même pour leurs propos sur le pouvoir politique. Dans certains cas leurs observations sur ces deux composantes fondamentales du politique (l’État et le pouvoir politique) invitent à la nuance, dans d’autres cas il est simplificateur à outrance. A certains endroits on retrouve une distinction franche et nette entre l’État et le pouvoir politique, alors qu’ailleurs on décèle une confusion navrante. Difficile donc, à travers un tel faisceau caractérisé par des analyses opposées de se lancer à la recherche d’une « théorie » unifiée de l’État et du pouvoir politique chez Marx et Engels. La définition de l’État, chez ces pères fondateurs du « socialisme scientifique » (sic) , n’est pas évidente. L’État est posé comme le défenseur de « l’intérêt commun », ailleurs on parle de « l’État de classe » ou de « l’État bourgeois » et finalement l’État se confond avec le pouvoir politique (l’État moderne-gouvernement). L’origine de l’État repose sur des déterminants discutables. Puisqu’il en est ainsi, on comprendra aisément pourquoi c’est en vain qu’on tenterait de trouver dans les écrits de nos deux auteurs une théorie d’ensemble et explicative de l’État en général et de l’État capitaliste en particulier. Chose certaine, Marx et Engels considèrent l’État de classe et le pouvoir politique avec défaveur. L’État centre de domination et de gouvernement aux mains de la classe économiquement dominante, la bourgeoisie, doit disparaître, s’éteindre. Dans les oeuvres de Marx et Engels l’État apparaît comme une « institution temporaire ». Son existence découle de la division sociale du travail et l’appareil d’État est un appareil voué entièrement à la réalisation de la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat.
L’apport d’Engels, dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, ne réside pas dans l’explication du rôle de l’État en tant qu’instrument de la classe dominante, ni des tâches qui doivent être celles du prolétariat par rapport à l’État bourgeois. Son apport fut de montrer comment le passage de groupes humains à une économie de production (avec l’agriculture et l’élevage) et non plus de prédation (comme chez les chasseurs-cueilleurs qui les avaient précédés), avait rendu possibles l’exploitation, la division de la société en classes et, du même coup, la naissance de l’État, comme organe se plaçant en apparence au-dessus des classes, chargé de maintenir l’ordre social existant, pour empêcher une guerre de classes permanente. Là s’arrête la contribution d’Engels dans l’analyse du phénomène étatique. Une analyse qui a été largement nuancée depuis.
Pour ce qui est des pratiques de rupture face à l’État, elles ne se posent plus au XXIe siècle dans les termes formulés par Marx et Engels au XIXe siècle. Les pratiques d’opposition et de contestation de l’institution étatique épousent aujourd’hui des formes qui semblent s’inscrire dans le cadre du système politique institué et de l’admission d’un certain nombre de règles explicites et (ou) implicites (le respect de la loi et le renoncement à vouloir éliminer l’adversaire). Mais ça c’est une autre histoire sur laquelle nous aurons peut-être l’occasion de nous intéresser éventuellement.
Yvan Perrier
BIBLIOGRAPHIE
Engels, Friedrich. 1888. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. IV : Le matérialisme dialectique. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1888/02/fe_18880221_4.htm . Consulté le 29 mai 2019.
Engels, Friedrich. 1973. L’Anti-Duhrinq. M.E. Duhring bouleverse la science. Paris : Éditions sociales, 501p.
Engels, Friedrich. 1974. L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État. Paris : Éditions sociales, 394p.
Marx, Karl. 1976. Le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Paris : Éditions sociales, 156p.
Marx, Karl. 1975. Contribution à la critique de l’économie politique. Moscou : Les éditions du progrès, 280p.
Marx, Karl. 1974. Les luttes de classes en France (1848-1850). Paris : Éditions sociales, 218p.
Marx, Karl. 1975. Critique du programme de Gotha. Pékin : Éditions en langues étrangères, 96p.
Marx, Karl. 1968. La guerre civile en France 1871. Paris : Éditions sociales, 127p.
Marx, Karl. 1965. Œuvres : Économie. 2 Tomes. Paris : Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard.
Marx, K. et F. Engels. 1977. L’idéologie allemande. Paris : Éditions sociales, 143p.
[1] Engels, Friedrich. 1974. L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État. Paris : Éditions sociales, 394 p.
[2] Scott, James C. 2019. Homo domesticus : Une histoire profonde des premiers États. Paris : La Découverte, 301 p.
…













Un message, un commentaire ?