8 avril 2025 | tiré de contretemps.eu
https://www.contretemps.eu/palestine-guerre-histoire-ilan-pappe-nettoyage-ethnique/
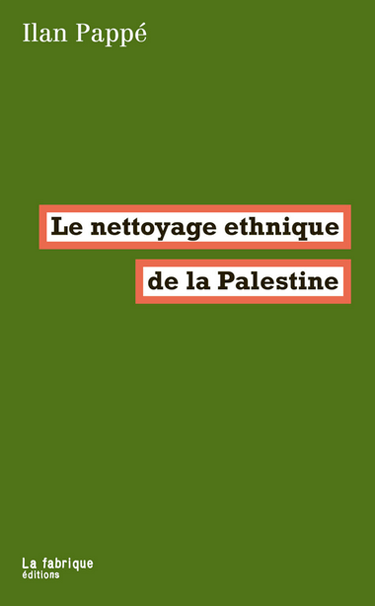
Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine (trad. Paul Chemla), Paris, La fabrique, 2024 (2006)
Le 13 mai 2024, Ilan Pappé, historien israélien, Professeur à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, est retenu à l’aéroport de Détroit et interrogé pendant deux heures par deux membres du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis à propos de ses opinions sur le Hamas et sur la riposte israélienne à l’attaque sanglante du 7 octobre 2023, ainsi que sur ses liens avec les communautés arabe et musulmane américaines[1].
« Saviez-vous, écrit-il dans un message posté deux jours plus tard sur le réseau social Facebook, qu’un professeur d’histoire âgé de 70 ans pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale américaine ? ».
Nulle participation à une quelconque conspiration politique contre Israël ou les États-Unis ne pouvait en effet justifier cet interrogatoire dans les règles de l’art, et force est de reconnaître que c’est en tant qu’historien, critique et engagé certes, que Pappé faisait figure de suspect idéal pour les autorités étasuniennes. Son délit : avoir inlassablement remis en cause le « roman national » israélien-sioniste, contesté le récit officiel de la guerre de 1947-1948 et de la naissance de l’État d’Israël, en s’efforçant de mettre au jour les mécanismes politiques et les opérations militaires qui, au lendemain du vote du Plan de partage de l’ONU et de l’annonce du retrait des troupes britanniques, avaient conduit à l’expropriation et l’expulsion d’environ 800 000 Palestiniens, soit deux tiers de la population arabe (musulmane et chrétienne) qui peuplait alors le territoire de la Palestine historique.
On imagine mal, à l’heure qu’il est du moins, un épisode comme celui qui vient d’être relaté se produire à l’aéroport Charles de Gaulle ou ailleurs sur le territoire français. Heureusement, il existe d’autres manières, plus douces, de tenter de réduire au silence des voix dissidentes comme celles de Pappé : il suffit, comme l’ont fait les éditions Fayard le 7 novembre 2023, un mois jour pour jour après l’attaque sanglante du Hamas et alors que la guerre de représailles mené par Israël ne faisait que commencer, de déclarer « épuisé pour cause d’arrêt de commercialisation » un livre phare de l’auteur, Le nettoyage ethnique de la Palestine, publié en anglais en 2006 et qui était disponible en traduction française depuis 2008.
Si l’éditeur a prétexté d’un contrat devenu « caduc », les chiffres de vente de l’ouvrage après le 7 octobre laissent penser qu’avec un peu de bonne volonté, et ne serait-ce que pour des raisons commerciales, le problème aurait pu être résolu, et que la soudaine indisponibilité du livre avait d’autres motivations, de nature politique, même si celles-ci sont condamnées à rester obscures[2]. On doit aux éditions La fabrique[3] d’avoir depuis acquis les droits du livre et assuré au Nettoyage ethnique de la Palestine une seconde vie à un nouveau moment crucial du combat pour la cause palestinienne, en tant que celui-ci est aussi et inséparablement – et c’est sur cet dimension que se centrera la présente lecture – un combat historiographique.
Il convient à ce titre de souligner que les conclusions de Pappé ne sont pas l’œuvre d’un franc-tireur isolé, mais le résultat de l’effort collectif mené, depuis 1978 et l’ouverture des archives israéliennes et britanniques de la guerre de 1948, par les « nouveaux historiens » israéliens, lesquels se sont patiemment attachés à déboulonner les mythes entourant la fondation d’Israël.
Ces historiens ont notamment remis en cause la représentation consacrée de la lutte héroïque du David israélien contre le Goliath arabe en démontrant que les forces juives-sionistes étaient en réalité bien mieux préparées, armées et organisées que leurs adversaires arabes, sur lesquelles elles disposaient en outre, si ce n’est pendant un court laps de temps, d’un notable avantage numérique. Mais le véritable tour de force des « nouveaux historiens » est d’avoir réfuté, preuves implacables à l’appui, l’idée selon laquelle l’exode massif de la population palestinienne aurait résulté de l’appel des dirigeants arabes à déserter les zones d’affrontement ; idée qui présentait cet insigne avantage d’exonérer l’armée et l’État israéliens de toute responsabilité dans les souffrances vécues par les exilé.es palestinien·nes[4].
Il revient ainsi à Benny Morris d’avoir posé en 1987 la première pierre de cette édifice critique dans son ouvrage séminal The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949[5], en montrant que l’expulsion des Palestiniens avait été littéralement orchestrée par les armées sionistes et s’était accompagnée de pillage des biens, d’expropriation et de destruction des habitations, voire à l’occasion d’exécutions sommaires.
Il y a toutefois un pas que Morris, au risque de se contredire, s’est toujours refusé à faire ; c’est celui qui consistait à soutenir que le déplacement forcé de la population palestinienne n’avait pas été un malheureux aléas de la guerre, une stratégie adoptée dans le feu du combat, mais le fruit, intentionnel, de l’exécution d’un programme mûrement réfléchi ; autrement dit, qu’une telle « évacuation » avait été soigneusement préméditée et coordonnée par les hautes sphères de l’Agence juive puis du jeune État israélien et de son organe paramilitaire, la Haganah, avec David Ben Gourion en maître d’oeuvre.
C’est précisément ce pas que fait témérairement Pappé. Celui-ci souligne en ce sens la fonction pratique endossée par les fichiers de villages arabes constitués dès avant la Seconde Guerre mondiale par la Haganah, et interprète le document établi en mars 1948 et connu sous le nom de Plan Daleth (« D » en hébreu), comme un véritable blueprint qui, scrupuleusement appliqué, aurait conduit au « transfert » de la population palestinienne et à la destruction de 500 villages et 11 agglomérations urbaines, avec pour point de non-retour le massacre de Deir Yassin du 9 avril 1948.
C’est depuis cette perspective que, sur quelques centaines de pages, Pappé, accumulant des faits plus accablants les uns que les autres, réexamine méticuleusement les opérations conduites entre décembre 1947 et janvier 1949 par la Haganah, et ses alliés inavoués pendant cette séquence, l’Irgoun et le groupe Stern en particulier.
Ce récit de violences vient nourrir la thèse centrale du livre, à savoir que ce qui a eu lieu sur le territoire de la Palestine, et à l’encontre des Palestinien·nes, sur cette période d’à peine plus d’un an, n’est rien d’autre qu’un nettoyage ethnique au sens strict que le terme a recouvert dans le contexte des guerres de Yougoslavie des années 1990 ; guerres dont Pappé cite en épigraphe de plusieurs chapitres des documents et analyses, notamment cet essai de définition donnée par le juriste Dražen Petrović :
« [L]e nettoyage ethnique est une politique bien définie d’un groupe particulier de personnes, visant à éliminer systématiquement d’un territoire donné un autre groupe sur la base de l’origine religieuse, ethnique ou nationale. Cette politique […] est à exécuter par tous les moyens possibles, de la discrimination à l’extermination, et implique des violations des droits humains et du droit humanitaire international. » (p. 25)[6].
C’est sur le déni du mal délibérément causé à la population palestinienne, et qui nourrit chez cette dernière un profond traumatisme, que vit selon Pappé la société israélienne toute entière, en sorte qu’il ne pourra y avoir d’issue, non seulement sur le plan (géo)politique, mais aussi sur le plan moral et existentiel, qu’à condition que « les Juifs israéliens [admettent] qu’ils sont devenus le miroir de leur proche cauchemar » (p. 302).
On ne s’étonnera guère que ces thèses aient suscité l’ire des historiens sionistes, qu’il suffise de citer une recension du Nettoyage ethnique de la Palestine publiée dans le Journal of Israeli History sous le titre « Cleansing History of its content » (Nettoyer l’histoire de son contenu) par Mordechai Bar-On, historien qui avait auparavant offert ses services à Tsahal et siégé à la Knesset. Déclarant que Pappé « ne mérite certainement pas le titre d’“historien” », lui reprochant de falsifier et fabriquer les faits, l’auteur ajoute : « Pappé ne cherche pas la vérité, comme un historien devrait au moins essayer de le faire, mais il prête sa plume aux efforts de propagande des éléments palestiniens les plus extrêmes pour tenter de délégitimer Israël et le sionisme. »
On pourrait simplement ignorer ce jugement lapidaire s’il n’émanait pas de quelqu’un qui, argument de façade ou non, en appelle dans le même temps Israël à reconnaître « le prix terrible que les Palestiniens ont dû payer pour la réalisation des aspirations juives en Palestine, mais aussi son propre rôle dans ce processus » [7], et s’il ne rejoignait pas ce faisant les arguments formulés par Benny Morris après son tournant (au début des années 2000 et à la suite de l’échec du sommet de Camp-David) vers un sionisme décomplexé, ouvertement anti-arabe, qui l’a conduit à assumer sans vergogne la nécessité de l’expulsion de la population palestinienne jusqu’à regretter que Ben Gourion n’ait pas osé prendre l’initiative de mener cette entreprise jusqu’au bout en vidant entièrement le territoire israélien de la présence palestinienne.
Dans une recension du livre précédent de Pappé, A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples (2004) publié dans The New Republic, Morris écrivait ainsi :
« Pappé est un fier postmoderniste. Il pense qu’il n’existe pas de vérité historique, mais seulement un ensemble de récits aussi nombreux que les participants à un événement ou à un processus donné ; et chaque récit, chaque perspective serait aussi valable et légitime, aussi vrai, que les autres[8]. »
Ce qui est reproché à Pappé, ainsi repeint en disciple d’Haydn White (ou de sa caricature), est en substance un mépris de l’objectivité induisant un relativisme extrême qui, certes, n’invaliderait pas sa restitution et son interprétation des faits comme telles, mais les rendraient ni moins ni plus crédibles que toutes les autres, dans une irréductible multiplicité à laquelle n’échapperaient en somme que des historiens de la trempe de Morris capables de surplomber le théâtre de la lutte et d’observer cette dernière à distance, avec un regard détaché et désintéressé.
Pappé ne tarda pas à répondre à Morris en retraçant les véritables coordonnées d’un conflit indissociablement historiographique et politique :
« Le débat qui nous oppose se situe à un certain niveau entre les historiens qui croient reconstruire purement objectivement le passé, comme Morris, et ceux qui revendiquent leur statut d’êtres humains subjectifs s’efforçant de raconter leur propre version du passé, comme moi. Lorsque nous écrivons des histoires, nous construisons des arcs sur une longue période de temps et nous forgeons un récit à partir du matériel que nous avons sous les yeux. Nous croyons et espérons que ce récit est une reconstruction fidèle de ce qui s’est passé, quoique […] nous ne puissions pas remonter dans le temps pour le vérifier. »[9]
Pappé poursuit en soulignant que les historiens israéliens qui produisent des récits historiques sur la genèse d’Israël et plus largement sur le conflit israélo-palestinien sont par nécessité « profondément impliqués dans le sujet sur lequel ils écrivent » ; qu’ils le veuillent ou nous, ils en font eux-mêmes partie, ce qui ne doit pas être considéré comme un « défaut » mais plutôt comme une « bénédiction ».
Ce n’est pas donc la reconnaissance et l’assomption de ce positionnement, mais au contraire sa négation, son refoulement, qui constitue une grave entorse à la probité intellectuelle de l’historien. Plus encore, il n’y a aucune honte à affirmer qu’un tel effort historiographique, visant à faire « valoir un point de vue » par rapport à d’autres, a toujours de manière avouée ou inavouée un soubassement « idéologique » ou « politique » ; en témoignent de manière éloquente les prises de position publiques de Morris lui-même, que celui-ci ne peut qu’avec une mauvaise foi avérée déclarer indépendantes de son travail scientifique, et réciproquement[10].
Un tel conflit de points de vue n’est nulle part plus manifeste, plus tranché, selon Pappé, que dans l’opposition entre l’historiographie sioniste et l’historiographie palestinienne :
« Les historiens sionistes voulaient prouver que le sionisme était valable, moral et juste, et les historiens palestiniens voulaient montrer qu’ils étaient des victimes et avaient été lésés[11]. »
Nous en arrivons à un des principaux points de contentieux entre Pappé et Morris, à savoir leurs rapports respectifs à la parole palestinienne, et en l’occurrence au (contre-)récit de la Nakba, terme introduit dès 1948 dans un livre de de l’historien et théoricien du nationalisme arabe Constantin Zureik : Ma’na al Nakba (La signification de la catastrophe). Sans rien dénier de l’apport des « nouveaux historiens » israéliens, scientifiquement en tant qu’historien, et politiquement en tant qu’Israéliens, force est de constater que la découverte de l’expulsion des Arabes n’en était nullement une du point de vue palestinien. Comme le dit Edward Said dans un entretien donné en novembre 2000, au lendemain du déclenchement de la seconde Intifada :
« Les archives sionistes sont très claires à ce propos, et plusieurs historiens israéliens ont écrit à ce sujet. Bien sûr, les Arabes n’ont jamais cessé de le dire[12]. »
Traduction d’une expérience traumatique, à la première personne, ce récit a nourri la littérature palestinienne et arabe post-1948 – voir par exemple les romans de Ghassan Kanafani Des hommes sous le soleil et Retour à Haïfa – mais a également fait l’objet fait d’une riche élaboration historiographique, et cela dès les années 1960, bien avant l’ouverture des archives, ainsi qu’en atteste l’essai pionnier « Plan Dalet. Master Plan for the Conquest of Palestine »[13] signé par Walid Khalidi, historien palestinien qui a documenté sans relâche les épisodes de la Nakba[14].
S’il arrivait à Morris de se référer au travail de Khalidi, ne se manifeste pas moins chez lui, comme chez d’autres une défiance tenace à l’égard des sources palestiniennes, là où Pappé, lui, n’hésite pas à affirmer qu’elles lui semblent souvent « plus fiables » que les sources israéliennes, et souligne ce qu’est susceptible d’apporter une connaissance de « terrain » de la vie dans les territoires occupés couplée à des contacts étroits avec des interlocuteur.ices palestinien.nes[15].
Bien qu’il ne le formule pas en ces termes, la relecture qu’il opère de la séquence 1947-1949 est indissociable d’un geste épistémologico-politique de refus de ce qu’on peut désigner comme un apartheid historiographique, dont tout un ensemble de perspectives sur l’histoire d’Israël, aussi critiques soient-elles, continuent de respecter et de reproduire scrupuleusement les frontières ; geste qui suppose, simplement, de reconnaître à l’autre, la capacité, à parts égales, de dire l’histoire ; geste enfin qui n’est pas sans implication politique puisqu’elle conduit Pappé dans Le nettoyage ethnique de la Palestine, à endosser, comme condition préalable à tout « processus de paix », une revendication fondamentale des Palestinien.es depuis la Nakba : le « droit au retour », qui « a été reconnu par l’Assemblée générale de l’ONU en décembre 1948 » et est « ancré dans le droit international » et est « en harmonie avec toutes les idées de justice universelle » (p. 311).
Pappé ne sous-estime pas l’ampleur de la tâche tant le « problème démographique », soulevé dès la fin du XIXe siècle par les idéologues sionistes, demeure prégnant en Israël, où les Palestiniens « ne peuvent pas ne pas comprendre qu’ils sont considérés comme un problème », voire comme un « danger » (p. 309-311). Ils le sont depuis le début dans la mesure où le projet sioniste s’est donné « pour objectif de construire puis de défendre une forteresse “blanche” (occidentale) dans un monde “noir” (arabe) », similaire à celle qu’avaient bâti les « colons blancs d’Afrique du Sud », avec pour paroxysme le régime d’Apartheid ; en sorte qu’Israël fait aujourd’hui figures de « dernière enclave européenne postcoloniale dans le monde arabe » (p. 315).
Ces thèses ne sont pas nouvelles en soi : les filiations entre les projets coloniaux-« civilisationnels » des puissances européennes des XIXe-XXe siècles, et l’idéologie sioniste, dans sa codification par Theodor Herzl déjà, ont été établies de longue date. Mais il n’en reste pas moins notable, et salutaire, qu’un historien israélien s’efforce de briser ce qu’Edward Said, amateur lui aussi de parallèles entre Israël et l’Afrique du Sud, a désigné comme une épistémologie de la séparation, corrélative de la séparation politico-légale des populations juive et arabe, et qui, visant à rendre par avance nulle et non avenue toute tentative de comparaison critique du conflit israélo-palestinien avec d’autres situations géo-historiques (conquête des Amériques, Algérie française ou autres), constitue une pièce nodale de l’ « idéologie de la différence » sur laquelle a reposé jusqu’à ce jour l’existence d’Israël[16].
Le livre de Pappé peut en définitive être lu comme une invitation à resituer systématiquement le cas israélo-palestinien, au sein d’une histoire globale des colonialismes, de peuplement plus spécifiquement, sans rien avoir à dénier de sa singularité. Mais c’est plus encore dans le sillage d’une riche tradition, celle des historiographies anticoloniales et antiracistes, historiographies de combat par excellence, que gagnerait à être réinscrit Le nettoyage ethnique de la Palestine ; un livre qui, pour ne prendre qu’un exemple, aussi étrange qu’il puisse paraître au premier abord, trouverait à dialoguer fructueusement avec l’œuvre de l’intellectuel africain-américain W.E.B. Du Bois, dont la pensée était toute entière gouvernée par une question lancinante : « quel effet ça fait [pour le Noir] d’être un problème ?[17] »
Pour Du Bois, prendre le contrepied des déformations et dénégations imposées par une historiographie dominante (blanche) masquant les logiques de pouvoir qui la sous-tendent, imposait d’assumer la particularité d’un point de vue situé, minoritaire, de s’engager sur le champ de bataille de l’écriture de l’histoire en rejetant la possibilité même de la neutralité sinon de l’impartialité, et in fine de se livrer à une authentique « propagande de la vérité »[18]. Mis à part le fait qu’il est lui-même issu de la « majorité », Pappé dit-il et fait-il aujourd’hui réellement autre chose que ce que disait et faisait Du Bois hier ?
Ce qu’il s’agit en définitive de (re)lier pour les éclairer mutuellement et ainsi miner l’idée de l’absolue exceptionnalité d’Israël, ce sont donc non seulement les formes d’oppression, coloniales, raciales ou autres, mais aussi les pratiques de résistance, et en l’occurrence de résistance historiographique, au passé et au présent, en œuvrant à ce qu’il conviendrait d’appeler une épistémologie de la connexion des luttes.
Notes
[1] « Ilan Pappé : « Pourquoi j’ai été arrêté et interrogé sur Israël et Gaza dans un aéroport américain », publié le 22 mai 2024.
[2] Voir Hocine Bouhadjera, « Fayard éclipse en catimini un de ses ouvrages sur la Palestine », publié le 8 décembre 2023.
[3] Les éditions La Fabrique avaient déjà fait paraître de manière précoce deux ouvrages d’Ilan Pappé : La guerre de 1948 en Palestine. Aux origines du conflit israélo-arabe en 2000 et Les démons de la Nakbah. Les libertés fondamentales dans l’université israélienne en 2004.
[4] Voir en français sur les « nouveaux historiens » israéliens, le travail de « passeur » joué en France par le journaliste Dominique Vidal : avec Joseph Agalzy, Le péché originel d’Israël. L’expulsion des Palestiniens revisitée par les “nouveaux historiens” israéliens, Paris, Les éditions de l’Atelier, 1998.
[5] Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2004 (1986).
[6] Faisons remarquer que Pappé n’a pas eu de scrupules à qualifier de « génocide » les opérations militaires israélienne de fin 2023-2024 sur la bande de Gaza (Rachida El Azzouzi, Entretien avec Ilan Pappé, « La guerre à Gaza n’est pas de l’autodéfense, mais un génocide », publié le 24 juin 2024).
[7] Mordechai Bar-On, « Cleansing history of its content : Some critical comments on Ilan Pappe’s The Ethnic Cleansing of Palestine », The Journal of Israeli History, vol. 27, no 2, septembre 2008, p. 269-270. On notera que la pure attitude de déni de l’expulsion des Palestiniens n’a pas disparu en Israël. Ne citons qu’un exemple éloquent : Eliezer Tauber The Massacre That Never Was. The Myth of Deir Yassin and the Creation of the Palestinian Refugee Problem, Washington, ASMEA et New Milford, The Toby Press, 2021.
[8] Benny Morris, « reviewing A History of Modern Palestine : One Land, Two Peoples by Ilan Pappe », The New Republic, publié le 22 mars 2004.
[9] Ilan Pappé, « Benny Morris’s Lie about my book », History News Network, publié le 5 avril 2004. Exerçant son droit de réponse, Pappé avait initialement adressé son texte à The New Republic, qui refusa de le publier.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] « Intifada 2000. The Palestinian Uprising » (2000), in David Barsamiam et Edward Said, Culture and Resistance. Conversations with Edward Said, Cambridge, South End Press, 2003, p. 31.
[13] Walid Khalidi, « Plan Dalet. Master Plan for the Conquest of Palestine » (1961), reproduit in Journal of Palestinian Studies, vol. 18, no 1, automne 1988, p. 4-33.
[14] Voir en français, Walid Khalidi, Nakba, 1947-1948, Beyrouth, Institut d’études palestiniennes et Arles, Sindbad-Actes Sud, 2012.
[15] Ilan Pappé, « Benny Morris’s Lie about my book », loc. cit.
[16] Edward Said, « An Ideology of Difference », Critical Inquiry, vol. 12, no 1, automne 1985, « “Race, Writing, and Difference », p. 38-58, reproduit in The Politics of Dispossession. The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969-1994, New York, Pantheon Books, 1994, p. 78-100.
[17] W. E. B. Du Bois, Les Âmes du peuple noir, trad. fr. M. Bessone, Paris, La Découverte, 2007, p. 11.
[18] W. E. B. Du Bois, Dusk of Dawn. An Essay Toward an Autobiography of a Concept of Race, New York, Oxford University Press, 2007 (1940), p. 113. Sur la pratique duboisienne de l’histoire, voir en particulier W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America. An Essay Toward a History of the Part Which Black Folk Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America, 1860-1880 , NewYork, Oxford University Press, 2007 (1935).












Un message, un commentaire ?