2 octobre 2023 | mediapart.fr | © Photo illustration Sébastien Calvet / Mediapart
Depuis au moins deux décennies, le revenu de base universel (RBU), autrement dit une allocation universelle et inconditionnelle versée aux citoyennes et citoyens, est présenté comme une solution aux problèmes sociaux et économiques du capitalisme contemporain. Cette proposition, qui peut paraître attirante, a néanmoins un revers : elle concentre la redistribution sur le versant monétaire et affaiblit ainsi la redistribution par les services publics.
Dans un ouvrage remarquable publié cette année aux éditions de l’Université de Chicago, Welfare for Markets (258 pages, 32,5 dollars, non traduit en français), deux chercheurs belges, Daniel Zamora Vargas et Anton Jäger, montrent que cette idée s’est en permanence construite contre la logique propre aux services publics. Et qu’une partie de la gauche a accompagné ce mouvement, lancé en grande partie par des penseurs néolibéraux.
Dans cet entretien, les deux auteurs reviennent sur les principaux éléments de leur thèse, qui permet de comprendre qu’au-delà des questions de financement, le débat entre revenu universel et services publics est bien un choix de société où le consommateur remplace le citoyen.
Mediapart : Votre ouvrage est titré « Welfare for Markets » (« Bien-être pour les marchés »), ce qui mobilise un double sens : la redistribution via le revenu de base universel (RBU) soutient autant les individus que les marchés. Cela vous permet d’introduire une différence fondamentale entre la redistribution en cash et celle en nature (les services publics). Toutes deux n’ont pas les mêmes effets sur la société ?
Daniel Zamora Vargas : On pourrait illustrer cette tension qui traverse les politiques sociales par un petit exercice de pensée. Imaginons deux sociétés qui seraient caractérisées par une distribution des revenus parfaitement égale. Tout le monde, dans ces deux pays, reçoit donc un revenu identique. Mais dans un des deux, une grande partie des richesses est socialisée, et dans l’autre, tout reste dans les mains du privé. En d’autres termes, dans une, vous recevez plus d’argent et dans l’autre, un peu moins, mais l’éducation, la culture, la santé ou les transports sont gratuits.
Du point de vue de la mesure des inégalités, ces deux sociétés sont parfaitement égales. Mais il n’est pas difficile de saisir en quoi elles sont également très différentes. Cette différence réside évidemment dans la place que l’on donne à la collectivité en matière d’investissement. Ou, pour le dire autrement, la capacité qu’ont ces sociétés à orienter les grandes décisions économiques.
Et ce à quoi l’on a assisté au cours des cinquante dernières années, c’est précisément un glissement d’un modèle à l’autre. L’État socialise moins et délègue l’investissement au privé, mais compense par des transferts monétaires directs aux entreprises sous forme de réductions d’impôts ou aux ménages sous forme d’allocations de toutes sortes. Il a en quelque sorte substitué la figure du consommateur à celle du citoyen.
Dans votre histoire du RBU, vous commencez par démonter les « fausses généalogies » qui font remonter le projet aux Gracques (réformateurs romains de la fin du 2e siècle avant notre ère qui proposait une réforme agraire) ou à Thomas Paine (penseur et révolutionnaire britannique de la fin du 18e siècle) . En quoi ces logiques étaient-elles différentes et pourquoi est-il important de comprendre cette différence ?
Anton Jäger : Il n’est guère surprenant que la plupart des histoires de l’allocation universelle participent de « l’invention d’une tradition » pour reprendre les termes de l’historien anglais Eric Hobsbawm. L’objectif de ces récits est de construire une mythologie qui soutiendrait la propagation d’une idée ayant une histoire et une tradition très anciennes. Ainsi, on retrouve dans ces livres des précédents dans l’Antiquité.
Comme toute tradition inventée, cela repose rarement sur une base factuelle solide. Les Gracques, ou même Paine, présupposaient une société largement agraire avec une économie monétaire assez restreinte, et le rapport avec la production était fort. Chez eux, l’impératif de travailler est central comme assurance contre les cycles malthusiens. Ils ont un lien primordial avec l’idée d’une constitution républicaine qui assurerait une distribution de propriété égale – la fameuse « loi agraire » proposée par les Gracques.
La vraie genèse de l’allocation universelle – la proposition proprement monétaire, avec un lien plus faible avec la propriété – se situe explicitement dans le vingtième siècle. Ce recul nous oblige aussi à parler des développements récents qui rendent l’idée plausible et même pensable. Et au fond, notre livre se penche précisément sur les conditions qui rendent son adoption attractive.

Daniel Zamora Vargas. © Daniel Zamora Vargas
Le vrai père du RBU serait donc Milton Friedman avec son projet « d’impôt négatif » dans les années 1940. En quoi cette proposition est nouvelle et quelle va être sa diffusion ?
Daniel Zamora Vargas : Milton Friedman a été effectivement l’un des premiers à envisager l’idée d’un revenu garanti lorsqu’il travaillait encore dans l’administration fédérale sur des sujets liés à la pauvreté. Il n’était cependant pas le seul et les propositions qui vont dans ce sens commencent réellement à proliférer durant l’entre-deux-guerres. C’est à cette période que se déroule un grand débat sur le socialisme parmi les économistes qui opposera notamment le néolibéral Hayek au socialiste Oskar Lange.
Et nombre d’entre eux vont exprimer un grand scepticisme face à l’idée que l’on puisse se passer du marché et des prix pour allouer les ressources dans la société. Cependant, dans le contexte de la Grande Dépression, même les plus ardents apôtres du marché devaient offrir une réponse aux inégalités produites par le capitalisme.
Et c’est dans ce cadre que Friedman va proposer son impôt négatif comme une alternative aux politiques centrées sur les services publics et le droit du travail, afin de garantir un niveau d’existence minimal sans pour autant limiter l’espace du marché. C’est pour cela qu’un des collègues de Friedman parlait d’un moyen de faire du « social sans État social ». Il faudra cependant attendre le milieu des années soixante, avec le lent déclin de l’État dirigiste forgé dans le contexte de la guerre, pour que de telles propositions sortent des séminaires d’économistes et soient réellement considérées au niveau politique.
Un des points importants de votre thèse est que ce projet de redistribution en cash a eu un impact fort auprès de la gauche. En France, il a même donné lieu à la « prime pour l’emploi » mise en place par le gouvernement Jospin en 2001 et qui est l’application de la proposition de Friedman. Est-ce un des axes de la conversion néolibérale de la gauche sociale-démocrate ?
Daniel Zamora Vargas : Disons qu’un des partis pris du livre était de se décentrer un peu du débat sur le néolibéralisme. Ce qu’on a voulu montrer, c’est que l’attrait par-delà les clivages partisans pour l’allocation universelle ne s’explique pas tellement par une conversion mais par un glissement plus général de l’économie vers un consensus néoclassique.
Il s’agit désormais d’être libre dans le marché, plutôt que d’être libre du marché.
Daniel Zamora Vargas
Ce n’est pas un hasard si les premières expérimentations d’allocation universelle sont lancées aux États-Unis sous une administration démocrate, à la fin des années soixante. Elles reflètent alors un basculement au sein même du camp keynésien. Si le New Deal mettait l’emphase sur la construction d’infrastructures et l’emploi public, les keynésiens modernisés vont plutôt défendre les réductions d’impôts et les transferts monétaires. Relancer l’économie tout en se reposant sur le secteur privé. Cette nouvelle génération de keynésiens tels que James Tobin ou Paul Samuelson va en réalité aseptiser les idées de l’économiste de Cambridge, au point de rendre la distinction entre keynésiens et non-keynésiens moins significative.
En ce sens, le tournant vers le marché précède largement ladite révolution néolibérale. Tant pour la social-démocratie modernisée que pour les néolibéraux, la liberté a été circonscrite à l’accès à la consommation. Il s’agit désormais d’être libre dans le marché plutôt que d’être libre du marché. La discussion porte alors uniquement sur le montant, plus généreux pour les uns, plus restrictif pour les autres.

Anton Jäger. © Anton Jäger
Votre critique de cette dérive de la gauche vers la redistribution en cash plutôt qu’en « nature » fait le lien avec la critique du travail à l’œuvre dès les années 1960, par exemple chez les situationnistes. Mais la critique du travail capitaliste ne débouche pas nécessairement vers ce type de solution marchande, elle peut aussi déboucher sur une critique radicale de l’argent, par exemple dans la « Wertkritik » (courant post-marxiste de la critique de la valeur qui prône l’abolition du travail et de l’argent). En quoi y a-t-il là un lien déterminant ?
Anton Jäger : Il est évident qu’une position anti-travail marxiste n’implique pas nécessairement le parti pris pour l’allocation universelle. Des penseurs comme Moishe Postone et André Gorz, tous les deux affiliés mais pas immergés dans les courants Wertkritik, ont toujours eu un rapport ambigu au propos : Postone semble souscrire à l’idée, même s’il garde les mêmes réserves que Gorz sur les effets pervers possibles.
Ce qui est clair néanmoins, c’est que la popularité de l’allocation universelle participe à une dynamique plus profonde au sein dans la gauche, qui présuppose la décentralisation du travail comme catégorie analytique et normative – une tendance qui malgré tout réunit la critique de la valeur et les rawlsiens de gauche (défenseur de la pensée de John Rawls centrée sur la recherche de la justice, ndlr) discutés dans le livre. Il semble que le travail n’est plus le point de départ naturel pour les théoriciens marxistes comme il l’était aux dix-neuvième et vingtième siècles. Évidemment, une telle tendance crée de l’espace pour penser des formes de politiques sociales qui ne présupposent pas une « anthropologie du travail » comme le notait Foucault déjà dans les années 1970.
Aujourd’hui, le RBU apparaît comme une solution de soutien à la société néolibérale fondée sur la marchandisation accrue. Peut-on imaginer qu’elle devienne une solution conservatrice ? C’est ce que vous suggérez en rappelant qu’elle a l’appui de nombreux milieux de la tech états-unienne. Mais alors, pourquoi ne l’est-elle pas encore et pourquoi la majorité des droites et des néolibéraux rejette-t-elle encore le RBU ?
Anton Jäger : Dans le livre, nous considérons le revenu de base comme la limite « asymptotique » d’un nouvel État-providence. Nous entendons par là que la proposition semble toujours sur le point de se concrétiser, sans pourtant jamais aboutir. Pourquoi ?
Certains critiques du livre nous ont reproché de prétendre que la proposition était déjà une réalité politique, mais ce n’est évidemment pas ce que nous soutenons. L’éternelle contradiction des propositions de revenu de base est que les propositions abordables sont insuffisantes et que les propositions suffisantes sont inabordables, notamment par l’ampleur des ressources nécessaires à leur financement.

© University press of Chicago
De plus, un revenu de base réellement généreux permettrait de se retirer plus facilement du marché du travail, ce qui aurait pour effet de renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs. Les chèques octroyés par Trump et Biden ont montré clairement qu’un afflux financier temporaire a aussi un tel effet, même si cela n’a pas de conséquences claires sur l’organisation du travail et ne stimule pas nécessairement l’action collective.
Mais au fond, il faut garder à l’esprit qu’en dépit des fantasmes d’une automatisation imminente, le capital a toujours besoin de travailleurs et n’a donc aucune envie d’affaiblir la discipline de la main-d’œuvre. Il est plus intéressant de monétariser les régimes de protection sociale : remplacer les modèles de services existants par du cash, offrant ainsi de nouveaux marchés aux entreprises, sans jamais pour autant distribuer suffisamment d’argent liquide aux gens pour leur permettre de quitter définitivement le marché du travail. Je ne suis pas sûr que nous assisterons de notre vivant à l’émergence d’un revenu de base complet dans un monde toujours dominé par le capital. Et ce, précisément parce que la révolution de l’automatisation n’a pas eu lieu.
Dans tout le livre, on perçoit que l’enjeu, au-delà du RBU, est celui de la définition des besoins. Là où le RBU et la redistribution en cash laissent le consommateur déterminer ses besoins sur le marché, soumis aux injonctions de la production de valeur, la redistribution en nature cherche à déterminer en amont des besoins à satisfaire directement. N’est-ce pas là le vrai clivage sur lequel la gauche doit se déterminer à l’avenir ?
Daniel Zamora Vargas : C’est probablement l’un des thèmes les plus importants du livre. Je pense en effet que l’attrait pour une définition monétaire de la pauvreté est allé de pair avec la dépolitisation des besoins.
Ce qu’on a essayé de montrer, c’est comment le marché a progressivement été présenté comme une institution neutre en matière de besoins. Comme si nous étions tout à fait libres d’acheter ce que nous estimons nécessaire à notre reproduction matérielle. Le marché ne ferait qu’enregistrer nos préférences et adapter la production aux besoins existants dans la société, exprimés sous forme de choix de consommation.
Si l’on prend cette perspective, il est évidemment supérieur à la planification vu qu’il n’impose pas certains choix à la population mais nous laisse tous libres d’utiliser notre argent comme on l’entend. Le problème est que c’est un peu réducteur.
Steve Jobs avait cette phrase célèbre pour expliquer son approche. « Très souvent, expliquait-il, les gens ne savent pas ce qu’ils veulent avant qu’on leur montre. » Cela s’applique évidemment à beaucoup de choses. Personne n’avait « besoin » d’un iPhone avant qu’il ne soit créé. Le marché ne répond pas à des besoins existants, il participe à les constituer, il les oriente.
La question centrale est, dès lors, comme l’avait déjà souligné l’économiste John Kenneth Galbraith dans les années 1950, la part de nos besoins qui sont délibérés collectivement, au travers d’une socialisation partielle de l’investissement, et celle qui est déléguée aux acteurs privés.
La question est celle des modalités au travers desquelles la société peut constituer ses besoins. Et c’est bien entendu cela qui a été le combat historique des socialistes. Marx lui-même s’était violemment opposé à un socialisme qu’il qualifiait de « vulgaire » et qui considérait la question de la répartition comme une chose « indépendante du mode de production et [représentait] pour cette raison le socialisme comme tournant essentiellement autour de la répartition ». Une meilleure répartition des richesses est évidemment souhaitable, mais n’est aujourd’hui plus suffisante pour affronter les défis contemporains.
Romaric Godin
*****
Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.
Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.
Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :




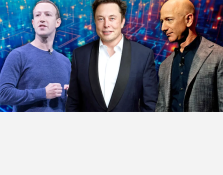







Un message, un commentaire ?