10 mars 2022 | tiré de mediapart.fr
Certes, le retour d’une guerre de haute intensité en Europe, portée par une puissance militaire majeure, n’est pas le fruit direct d’une tension économique. Les causes immédiates sont sans doute à chercher dans la renaissance de l’impérialisme russe et dans la montée de l’autocratie à Moscou. Mais ces sources elles-mêmes ne sont certainement pas indépendantes des conditions économiques. Une guerre de grande ampleur contre un pays de 44 millions d’habitants ne s’engage pas sans qu’une lecture du contexte économique ne soit prise en compte.
Aussi doit-on s’efforcer de saisir le conflit dans le cadre de l’évolution du système capitaliste avant son déclenchement. Le premier élément de réponse réside dans la situation russe elle-même.
Les origines du modèle économique russe
La Russie est un pays traumatisé par la « thérapie de choc » des années 1990, qui était censée apporter la prospérité et assurer son maintien parmi les grandes puissances économiques du monde. Cette stratégie a été un désastre absolu. Le PIB russe s’est effondré et avec lui a disparu l’essentiel de la capacité industrielle du pays. Selon la Banque mondiale, en PIB par habitant et en parité de pouvoir d’achat, la Russie n’a retrouvé son niveau de 1990 qu’en 2006.
Ces seize années de stagnation n’ont cependant pas été suivies d’une forte accélération de la croissance. Certes, entre 2006 et 2013, la croissance annuelle moyenne du PIB par habitant a été tirée par la hausse du prix des matières premières et le PIB a augmenté de 2,5 % par an, ce qui n’est pas très élevé pour une économie en rattrapage. Une fois cet effet prix disparu, et les premières sanctions après l’occupation de la Crimée mises en place, l’économie russe est entrée en phase de stagnation : entre 2013 et 2019, le PIB par habitant a progressé de 0,6 % en moyenne chaque année.

Ce cadre général ne rend pas compte de la modification de l’économie politique de la Russie. Du chaos de la thérapie de choc à la crise financière de 1998, a émergé un système économique dominé par des « oligarques », ceux-là mêmes qui avaient profité des privatisations massives dans une ambiance de corruption dans les années 1990, mais « arbitré » par un pouvoir politique fort incarné par Vladimir Poutine. Dans les années 2000, l’État se fait ainsi « respecter » par les oligarques alors que, jusqu’ici, il était le terrain de jeu de ces derniers.
L’arrestation fin 2003 de Mikhaïl Khodorkovski agit comme le tournant de cette évolution. Désormais, l’État autoritaire récupère une partie de la valeur et l’utilise dans le maintien de son pouvoir. Et ceux qui ne jouent pas le jeu de la collaboration avec le pouvoir sont implacablement réprimés.
La kleptocratie qui a émergé de la thérapie de choc n’a pas été supprimée, elle a été réorganisée par l’État dans l’intérêt de la classe dirigeante. Un tel régime n’est donc pas un régime redistributif. La confiscation des fortunes des oligarques récalcitrants se fait au bénéfice de proches du pouvoir, avec comme fonction le renforcement de ce dernier.
Dans cette structure, la Russie poutinienne tolère donc en grande partie l’évasion de valeur menée par les oligarques vers les paradis fiscaux et leurs lieux de résidence à Londres ou dans les pays méditerranéens. Mais une partie de cette valeur est récupérée par l’État pour assurer l’enrichissement personnel des dirigeants, une partie des investissements non réalisés par le secteur privé et le renforcement de l’appareil sécuritaire. Les oligarques continuent de s’enrichir, les dirigeants assurent leur maintien au pouvoir.

Les perdants, c’est la masse des Russes qui ne touchent que les miettes d’une telle politique. Les inégalités dans le pays sont massives. Selon les données de la World Inequality Database (WID), les inégalités de revenus, qui se sont un peu réduites depuis 20 ans, restent à un niveau très élevé, que ce soit historiquement ou en comparaison.
Les 1 % les plus riches captaient ainsi en Russie en 2020 pas moins de 21,4 % du revenu total, contre 17 % pour les 50 % les moins riches. Certes, en 2000, les 1 % captaient 26,6 % du revenu contre 13,1 % pour les 50 %, mais on est loin des chiffres de la fin de l’époque soviétique, où les 1 % captaient 5 % du revenu total, tandis que les 50 % obtenaient 28 %. À titre de comparaison, en France, les 1 % les plus riches captaient en 2019 9,9 % du total, les 50 % obtenant 22,7 %.
Mais l’essentiel réside dans les inégalités de patrimoine, vrai indicateur de l’accumulation de capital et donc du régime économique. En 2020, 47,7 % du patrimoine total était détenu par 1 % de la population, contre 3,1 % pour la moitié la moins fortunée de la population. De ce point de vue, les inégalités se sont même creusées depuis 20 ans puisqu’en 2000 les 1 % détenaient 39,2 % du patrimoine total. La situation est donc encore loin de celle de la France, où les 1 % détiennent 26,1 % du patrimoine total, et même des États-Unis, où cette part est de 34,5 %.
Globalement, le développement russe post-soviétique est un échec. La Russie n’est pas redevenue la grande puissance économique qu’était l’URSS. Son PIB nominal est resté inférieur à celui de l’Italie et son PIB par habitant a été dépassé par celui de la Pologne et est désormais talonné par la Chine, deux pays jadis très loin des niveaux de richesse de l’ancienne URSS.
Dangereuses contradictions
Elle est clairement dans le camp des perdants de l’évolution économique mondiale des 30 dernières années. C’est un pays centré sur l’extraction de ressources et qui, pour reprendre les termes des penseurs de l’impérialisme, est voué à être une périphérie fournisseuse de matières premières du centre.
Un tel système est intrinsèquement parcouru de contradictions dangereuses. Le maintien du pouvoir repose à la fois sur l’idée d’une amélioration de la situation des masses au regard des années 1990, mais aussi sur le maintien d’une accumulation ultra-concentrée.
La résolution de cette contradiction est complexe. Elle implique évidemment la répression, mais aussi une politique nationaliste. C’est un ressort habituel de ce type de régime pour maintenir l’ordre. Dans le cas russe, cela s’appuie sur un sentiment de revanche et de sursaut faisant suite aux reculs de la zone d’influence russe depuis la fin des années 1990.
Mais ce ressort vient ouvrir une autre contradiction : l’héritier de la puissance militaire soviétique dispose effectivement d’un arsenal militaire de grande puissance tout en étant une puissance économique secondaire. Face à ces contradictions, la tentation de la fuite en avant pour un régime autoritaire semble logique. Incapable de développer le pays économiquement, le pouvoir russe ne pouvait, pour assurer sa stabilité, qu’investir massivement dans la seule force dont il disposait : la force militaire.
L’impérialisme régional russe devient alors la conséquence logique de ces contradictions. Le discours « chauviniste grand-russe », pour reprendre les termes de Lénine, permet de dissimuler derrière la persistance de la puissance militaire et de la revendication d’une aire d’influence la faiblesse intrinsèque de l’économie nationale et l’incapacité du régime d’améliorer le bien-être global de la population. Il permet aussi d’avoir accès à de nouvelles ressources, ce qui explique notamment le développement de l’influence russe au Sahel, par exemple.
L’impérialisme russe et sa logique
Ce développement de l’impérialisme russe a conduit naturellement à des frictions avec d’autres zones d’influence, notamment celle des pays occidentaux, et le cœur de cette friction est devenu l’Ukraine à partir de 2014. Il est alors important de se souvenir que le capitalisme est d’abord une extension, y compris spatiale.
Lorsque l’extraction de valeur est de plus en plus difficile à réaliser, comme c’est le cas depuis les années 1970 et encore plus depuis 2008, l’expansion géographique pour ouvrir des marchés, trouver des ressources et de la main-d’œuvre bon marché est incontournable. Le retrait soviétique en Europe centrale et orientale s’est ainsi conjugué avec l’expansion économique allemande et son corollaire militaire états-unien. Dans ce cadre, entre deux capitalismes en recherche d’expansion, le choc était inévitable.
La crise de 2014 a alors plongé le régime russe dans une fuite en avant dangereuse. Les sanctions qui ont suivi l’invasion de la Crimée et le soutien aux séparatistes de Louhansk et Donetsk ont conduit Moscou à construire la « forteresse Russie », une économie jugée moins dépendante de l’extérieur et plus autonome. Cette politique a cependant encore aggravé les contradictions internes au régime.

Certes, la Banque centrale russe a réduit la dépendance au dollar et s’est appuyée sur l’excédent commercial du pays pour construire d’impressionnantes réserves en devises et en or. De son côté, pour ne plus faire appel au financement étranger, le gouvernement russe a réduit son déficit budgétaire pour dégager un excédent à partir de 2018.
Cette politique « autarcique » est aussi classique pour un pays qui se considère comme « isolé » économiquement tout en ayant des ambitions impériales. C’est celle menée par l’Italie fasciste, par exemple. Dans le cas russe, cependant, cette politique a conduit à deux points de contradiction.
D’abord, cette « forteresse » s’est construite sur la répression de la demande intérieure. Tout excédent commercial est le signe d’une sous-consommation. L’excédent budgétaire et la politique de taux élevés de la banque centrale sont des outils pour assurer cette sous-consommation. La Banque centrale de Russie a augmenté ses taux de 9,5 % à 20 % après l’invasion de l’Ukraine, ce qui risque de tuer l’activité du pays. Mais il est important de noter que, déjà, à 9,5 %, le taux d’escompte russe était élevé au regard des grands pays avancés, y compris en termes réels (0,75 % en janvier 2022, contre − 5 % en zone euro, par exemple).

En 2018, le projet de réforme des retraites avait provoqué une rare poussée de mécontentement social dans le pays qui, fait encore plus rare, avait contraint Vladimir Poutine à reculer en partie. Il avait renoncé à relever l’âge de départ des femmes de 55 à 63 ans pour le fixer à 60 ans, relevant celui des hommes de 60 à 65 ans.
Ce recul partiel avait permis de prendre conscience du prix de la « forteresse Russie » pour la population et de révéler, derrière le rideau du régime, l’état réel de la tension sociale. Globalement depuis 2014, les revenus du travail sont d’ailleurs sous pression, avec un ralentissement continuel de la croissance du salaire réel en tendance. En février 2021, le FMI lui-même soulignait que « le revenu par tête progresse faiblement et ne converge pas vers les niveaux des économies avancées ». Ce qui n’empêchait pas le Fonds de saluer les mesures de « ciblage » des politiques sociales annoncées par le gouvernement Poutine.
Au total, l’économie russe, aussi résistante soit-elle, s’appuie sur un sous-jacent faible. En décembre 2021, la Banque Mondialeconfirmait la faiblesse globale de la croissance potentielle russe au regard de sa situation de pays émergent, faute de dynamisme de la productivité, d’industrie et de forte croissance de la demande. Le maintien de la paix sociale devenait d’autant plus complexe que la crise sanitaire est venue creuser le budget russe. Pour la population, l’amélioration globale de son sort devenait de plus en plus lointaine. D’ailleurs, en Russie comme dans le reste du monde, la reprise post-Covid commençait à s’épuiser et l’inflation accélérait malgré un resserrement des taux. Au troisième trimestre 2021, le PIB russe a reculé de 1,2 % sur un trimestre.
Une telle situation ne pouvait donc qu’inciter le régime à relancer la logique impérialiste. D’autant que le succès apparent de la « forteresse Russie » donnait une forme d’assurance dans sa capacité à résister à de nouvelles sanctions. Les conditions d’un basculement du régime dans l’agression de l’Ukraine étaient ainsi largement posées : un contrôle du voisin permettrait dans cette logique de ressouder la population (éventuellement de lui faire accepter de nouveaux sacrifices) autour du prestige militaire, mais aussi de disposer de nouvelles ressources, notamment agricoles. Pour un pays construit autour de l’extraction de ressources, la proie pouvait être tentante. Et il pouvait s’agir de résoudre les contradictions propres au capitalisme russe.
Dans ce cadre, l’agression russe dispose aussi d’une logique économique qui prend ses racines dans le désastre qu’a été la transition des années 1990. Ironiquement, la thérapie de choc s’inscrivait dans un contexte où l’établissement général d’un régime néolibéral marquait la « fin de l’histoire ». Or c’est aussi sur les ruines de ce mythe économique que rebondit aujourd’hui l’histoire.
Un conflit entre deux capitalismes ?
Reste une question. Ce conflit russo-ukrainien, qui s’est déjà étendu indirectement, et notamment sur le plan économique, au reste du monde, est-il un conflit entre deux « modèles » ? En 2019, l’économiste serbo-états-unien Branko Milanović émettait dans son livre Le Capitalisme, sans rival (La Découverte, 2019, discuté ici) l’hypothèse que le capitalisme contemporain, désormais unique mode de production mondial, serait divisé en deux variantes : le capitalisme « libéral méritocratique » de l’Occident et le capitalisme « politique » issu notamment d’une accumulation primitive réalisée par l’expérience du « socialisme réel ».

© La Découverte
Les caractéristiques de ce dernier reposent sur l’existence d’un État fort contrôlant directement ou indirectement le secteur privé par l’absence d’État de droit et la corruption. Dans la préface à l’édition française, Pascal Combemale résume la différence entre les deux systèmes : dans le système libéral, « le pouvoir économique donne accès au pouvoir politique » et dans le capitalisme politique, « c’est l’inverse ». Et d’ajouter : « Dans les deux cas, la concentration des pouvoirs bénéficie à une élite qui tend de plus en plus à se reproduire. »
Branko Milanović insiste beaucoup sur le cas chinois comme étant l’idéal-type du capitalisme politique et n’évoque qu’en passant le cas russe. Mais ce dernier pourrait répondre plutôt bien à cette définition. Les événements actuels pourraient laisser croire que c’est cette division entre ces deux types de capitalisme qui est en jeu dans le conflit ukrainien. La guerre en Ukraine serait finalement le premier acte du conflit central entre Russie et États-Unis que chacun prévoyait à plus ou moins long terme.
Certains éléments pourraient même aller dans ce sens. La volonté des Occidentaux de frapper « l’oligarchie » russe confirmerait le caractère politique du pouvoir économique. Par ailleurs, les votes aux Nations unies semblent dessiner deux camps qui recoupent en partie cette division entre les deux types de capitalisme. D’un côté, l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et l’Asie du Sud-Est « libérale », et de l’autre la Chine, la Russie, l’Inde, le Vietnam, l’Amérique latine « socialiste » et certains pays d’Afrique désormais fortement liés à la Chine et à la Russie.
Mais cette division apparente ne doit pas tromper. En réalité, cette division semble très discutable dans le contexte actuel. D’abord, la pandémie a fait évoluer le capitalisme vers un modèle plus unifié où l’État agit comme une sorte de garant en dernier ressort du secteur privé, ce qui tend partout à concentrer pouvoirs économique et politique et à politiser de plus en plus les choix économiques. Dans ce contexte, les définitions des deux ensembles semblent s’effacer ou, du moins, s’amenuiser.
Les sanctions contre la Russie font ainsi bon marché de certains fondements de l’État de droit tel qu’il est conçu dans le droit occidental, comme le respect de la propriété privée. Ce n’est pas étonnant et cela arrive régulièrement en temps de conflit, mais c’est aussi le signe de la politisation de l’économie dans le capitalisme dit « libéral » de Milanović. Ce dernier avait déjà, d’ailleurs, dans son livre, émis l’hypothèse d’une fusion entre les deux modèles. Et cette vision a été confirmée dans un texte écrit après l’invasionoù il confirme le caractère politique du capitalisme contemporain.
Au reste, même si le cas russe est extrême, on sait que les liens entre puissance économique et puissance politique existent dans les économies occidentales. Depuis un demi-siècle, ces économies ont même pris, avec la pseudo-théorie du ruissellement et ses variantes (« les baisses d’impôts pour favoriser les investissements »), un chemin où l’État ménage la puissance économique et favorise le creusement des inégalités.
En réalité, la Russie a été dans les années 1990 le laboratoire des idées néolibérales pro-riches. Et que le modèle économique russe est le fruit de cette expérience. C’est donc une sorte de forme poussée à bout des lubies néolibérales. Mais alors, la différence entre les deux modèles de capitalisme devient principalement une différence d’intensité et non de nature.
L’autre élément est que, quand bien même la division entre les deux capitalismes existerait et perdurerait, les lignes sont assez floues. Des pays de l’UE comme la Pologne et la Hongrie auraient trouvé leur place dans le capitalisme politique, mais sont alignés sur les positions occidentales.
Les États-Unis tentent, pour assurer leur approvisionnement en pétrole, de se rapprocher du Venezuela, qui a voté contre la condamnation de l’agression russe à l’ONU. Plus fondamentalement, l’Ukraine elle-même ne peut apparaître comme un membre du capitalisme libéral occidental, même si, sous la pression du FMI, elle tente de s’en rapprocher. L’élément de modèle économique ne semble pas ici jouer un rôle majeur. C’est bien plutôt la nature de l’influence dominante qui est déterminante.
Quant à la Chine, si elle n’est pas solidaire de la Russie, elle est, comme l’Inde ou d’autres, dans une position opportuniste où elle tente de sauvegarder les importations russes, tout en ménageant ses accès aux marchés occidentaux, qui restent vitaux pour elle.
Rien ne laisse présager ces jours-ci un « bloc idéologique » russo-chinois fondé sur un modèle économique commun. Au reste, il n’y a là rien d’étonnant : le modèle économique chinois est assez différent de celui de la Russie, ne serait-ce que parce que la thérapie de choc n’a pas été appliquée en Chine.
Certes, la République populaire traverse aussi une forme de crise et n’hésite pas elle-même à avoir recours à l’impérialisme. Mais, précisément pour cette raison, elle est aussi concurrente de la Russie : c’est le cas en Afrique, mais aussi, on l’a vu plus récemment, au Kazakhstan et en Asie centrale.
Dans son ambition de construire une croissance plus équilibrée, Pékin agit prudemment et ne peut se passer de son accès aux marchés occidentaux. Tout alignement sur la Russie mettrait ces débouchés en danger, mais en ne coupant pas les ponts avec Moscou, la Chine entend aussi pouvoir profiter des besoins de ce pays désormais affaibli. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre la possibilité de rachat de parts dans les grandes entreprises d’État russes par Pékin annoncée le 8 mars. En réalité, la Chine continue de prendre en compte les interdépendances que les États-Unis et la Russie tentent d’effacer.
Les événements actuels viennent confirmer ce que l’on savait depuis 1914 : la domination mondiale du capitalisme n’est pas la garantie de la paix, y compris lorsqu’elle s’appuie sur des interdépendances commerciales. Dans un capitalisme structurellement en crise où il est de plus en plus difficile de dégager de la croissance, les logiques géopolitiques peuvent prendre le dessus pour s’approprier de nouvelles ressources, de nouveaux marchés ou apaiser des tensions sociales internes.
Lorsque, comme dans le cas russe, la contradiction entre la faiblesse de l’économie et la puissance militaire s’accroît, le conflit apparaît comme une possibilité sérieuse. Et les interdépendances commerciales sont mise à mal, soit parce qu’on les croit plus solides qu’elles ne sont, soit parce qu’on juge que les gains potentiels de leur rupture sont plus élevés. Les turbulences économiques issues des années 1990 et des crises successives qui ont eu lieu depuis 2008 ont donc rendu le monde plus dangereux. Dès lors, la guerre en Ukraine est moins un choc entre deux types de capitalisme qu’un nouveau symptôme d’un capitalisme en crise.
Romaric Godin








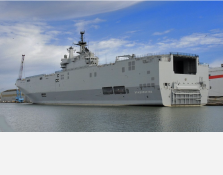



Un message, un commentaire ?