Et là je mettrais tout de suite les choses au clair : ce que je mets en cause, ce ne sont pas ses aspirations radicales, écosocialistes ou même liées au municipalisme démocratique ou libertaire que je pourrais partager en grande partie. Ce n’est pas non plus ses volontés anti-racistes ou encore ses désirs d’égalité entre hommes et femmes dont je suis, et qui ,soit dit en passant, ne datent pas d’aujourd’hui mais ont hanté les luttes de certains secteurs de la gauche du passé, en particulier pendant les périodes révolutionnaires de l’histoire des peuples du 19ième et 20ième siècle.
Non, ce que je questionne ici c’est un ton nouveau, ou plutôt une manière d’aborder politiquement les choses, qui semble vouloir faire fi de tout ce qu’il y avait de plus prometteur dans les meilleures traditions de la gauche.
Porter sur ses épaules tous les péchés du monde ?
De quoi s’agit-il ? D’une propension à tout penser d’abord à partir de soi et de son senti personnel, sur le mode individuel et moral, en donnant, qui plus est, l’impression —et c’est ce que l’on entend en lisant le texte de Jonathan— que l’on porte sur ses épaules tous les péchés du monde, et qu’on ne peut se départir d’une culpabilité intrinsèque qu’en faisant, sur le mode de la confession publique !, des mea culpa à répétition.
Qui ne verrait pas ici ressurgir en pointillé, cette formidable culpabilité d’origine religieuse, judéo-chrétienne et occidentale (le fameux péché originel !), dont justement toute la modernité, et en particulier les courants socialistes et anarchistes qui ont donné naissance aux traditions de gauche, ont cherché peu à peu —au nom des exigences d’une liberté collective fièrement revendiquée— à s’émanciper ?
Et là, il vaut la peine de s’arrêter à ce qu’il en est de la liberté ou plutôt des "libérations" collectives possibles auxquelles chacun d’entre nous peut chercher à participer. Car cela touche non seulement à la question de l’enseignement, mais aussi à celle de la cité toute entière.
La liberté dans la cité
C’est Raoul Vaneigem —un anarchiste-situationniste de la vieille école— qui avait cette si belle formule à propos de l’art d’enseigner : "la clef de la connaissance est la clef des champs où l’affection est offerte sans réserve". Et j’aimais bien commencer mes cours ainsi, car justement elle montre que non seulement la liberté devrait être l’objectif premier de tout enseignement, mais aussi et surtout qu’elle est quelque chose qui n’est pas donné a priori à chacun d’entre nous, mais qui se conquiert difficilement et avec d’autres, justement en osant dépasser ses propres peurs et en apprenant ensemble à se confronter à (et non pas à se protéger de !) de toutes les beautés mais aussi de toutes les horreurs du vaste monde. D’où l’importance de l’affection du professeur qui soutient et renforce la détermination de ses étudiants dans cette quête. Et qui le fait, certes avec une infinie bienveillance, mais aussi à travers ce qu’on devrait nécessairement appeler "un dialogue confrontatif" (pensez- à ce propos à la maieutique de Socrate) parce qu’il sait que —loin de toute victimisation— ce n’est qu’en expérimentant la possibilité d’acquérir du pouvoir sur sa propre vie (par exemple en se confrontant à des idées qui ne sont pas les siennes et en s’en forgeant qui lui soient propres) que l’on peut commencer à prendre le chemin de la liberté. Et quelque part, c’est la même chose au niveau de la cité démocratique. Et cela parce que, comme le rappelle Hannah Arendt, la politique démocratique renvoie toujours à cet espace de discussion et d’échange libre qu’il faut pouvoir installer entre les êtres humains ; et parce que la démocratie pour nous est née —comme chacun le sait— en Grèce de cette idée que tout peut être dit dans la transparence d’une place publique —loin des censures, des mystères et des privilèges imposées par les des castes religieuses ou aristocratiques.
Tout ça pour dire que la liberté, tant dans l’enseignement que dans la vie politique, devrait être considérée, quand on est de gauche, comme un principe de base qui ne pourrait être limité qu’en des cas extrêmes. Impossible de ne pas se souvenir de cet appel de Rosa Luxembourg : "(...) la liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Non pas par fanatisme de la "justice", mais parce que tout ce qu’il y a d’instructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté politique tient à cela et perd son efficacité quand la "liberté" devient un privilège".
Et pourquoi faut-il mettre tant d’emphase sur ce principe, c’est que justement, quand on est de gauche, on sait que tout ne dépend pas du seul individu, de ses bonnes volontés et intentions, de sa responsabilité, de son sens du devoir —aussi noble soit-il- mais aussi et surtout en même temps de l’histoire collective dont il vient (et dont il hérite bien malgré lui) des dynamiques et structures socio-économiques, des classes qui agissent en quelque sorte dans son dos, à son insu, malgré lui. En somme l’individu n’est qu’une partie d’un tout plus vaste, d’une formation sociale à laquelle il appartient et sans laquelle —si celle-ci ne se met pas en mouvement à son tour--- il ne peut rien faire de décisif.
Les races existent-elles ?
Mais là avant d’aller plus loin, j’aimerai juste faire —dans le sillage des conditionnements qui peuvent peser sur nous— un petit aparté à propos de thèses soit disant "sociologiques" de Robin DiAngelo, Fragilité blanche. Ce racisme que les blancs ne voient pas, Paris, Les Arènes, 2020. Car dans son texte, Jonathan semble les reprendre à son propre compte de manière totalement a-critique, alors qu’elles sont —et je pèse mes mots— extrêmement questionnables. Ne serait-ce que parce que le concept de race et à fortiori de race blanche (en tant que détermination rigoureuse de réalités qui sépareraient et hiérarchiseraient le genre humain) n’existe tout simplement pas : toute la science contemporaine s’est employée justement à le démontrer, faisant voir par exemple qu’il peut y avoir plus de proximité génétique entre deux personnes dites de "races" différentes (par exemple l’une d’origine africaine, l’autre d’origine japonaise), qu’entre 2 Québécois de souche (comme on dit) vivant sur le même palier. Ce qui existe par contre, ce sont des discriminations d’ordre économique et culturel qui n’ont rien à voir au départ avec la couleur de la peau, mais avec des positionnements de classe et les terribles aléas de l’histoire qui ont vu, dans le sillage du développement capitaliste, l’Europe partir à la conquête du monde et installer de formidables inégalités socio-économiques entre peuples du nord et peuples du sud. Et ce sont celles-là qu’il faut d’abord combattre.
Mais revenons aux conditionnements collectifs qui pèsent sur nous, car si on se propose, quand on est de gauche, de faire de la politique, c’est justement pour cette raison : pour se donner les moyens réels d’agir sur les conditionnements socio-économiques qui nous déterminent et qui renvoient toujours à la façon dont se comporte une société dans son ensemble. Or bousculer les conditionnements socio-économiques et collectifs, c’est justement ce que ne peut pas faire la morale (puisqu’elle répond d’abord à la préoccupation individuelle du que "dois-je faire ?"). C’est déjà en son temps ce qui faisait dire au jeune Marx que "la morale c’est l’impuissance en action, toutes les fois qu’elle s’attaque au vice, elle a le dessous", puis un peu plus tard que " "les hommes font leur propre histoire, mais dans des conditions non choisies par eux, ajoutant.... que "le passé pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants".
Un art de la stratégie
Ce qui bien évidemment implique de voir la politique comme un art de la stratégie, un art complexe permettant que, dans des conditions données et soigneusement prises en compte, la société entière puisse se mettre en mouvement dans la direction que l’on souhaite. En se rappelant cependant que cela ne pourra se faire —y compris dans le sillage d’une hypothétique prise de pouvoir révolutionnaire du pouvoir d’État— que par le biais de larges alliances passées entre classes populaires, discriminées et subalternes, ainsi qu’à travers de vastes transitions historiques au fil desquelles, comme dit Bertold Brecht, "l’homme pourra enfin devenir un ami pour l’homme". D’où d’ailleurs la nécessité de ne pas se focaliser sur son seul pouvoir personnel, sa seule responsabilité individuelle dans l’ici et maintenant et de privilégier, au travers du débat le plus large et démocratique qui soit, la lutte politique, c’est-à-dire la constitution d’une puissance collective commune susceptible de devenir dans le temps une véritable force de changement agissant dans la durée.
On peut bien sûr dans l’ici et maintenant et à son propre niveau d’individu —ce n’est pas rien, il est vrai— faire tout pour vivre par exemple plus d’égalité au quotidien, avec ses semblables, qu’ils soient femmes, d’origine immigrante, ou d’origine autochtone et africaine. On peut même chercher à participer à ce qu’il y ait dans son milieu de travail, au parlement et dans les conseils d’administration autant d’hommes que de femmes, autant d’artistes autochtones ou africains qu’immigrants, etc. Mais, sans jamais imaginer pour autant qu’on en porte individuellement la responsabilité ultime. Comme si, comme petit individu, nous pouvions nous extraire, d’un coup de baguette magique, des formidables contraintes sociales dans lesquelles nous baignons tous et toutes. Car tant qu’on ne se sera pas attaqué en même temps aux structures économiques et sociales collectives qui, en notre société capitaliste et néolibérale, ne cessent de reproduire les conditions de l’inégalité (pensez par exemple à l’abime qui existe, en termes de conditions de travail, entre médecins et infirmières), on ne fera que de bien petits pas (minés en permanence par les logiques de la réification capitaliste), en somme on n’en restera qu’à la superficie des choses, un peu comme l’on change un mot, sans changer la réalité à laquelle il fait référence.
Or c’est justement ce qui est préoccupant : que cette nouvelle gauche paraisse oublier ces évidences premières !








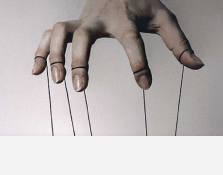




Messages
1. De quelques réflexions autour de la confession de Jonathan Folco, 6 novembre 2020, 15:22, par Yves Chartrand
Bonjour Pierre,
Je n’ai pas lu le texte de Jonathan Durand Folco mais je veux réagir positivement au vôtre. J’aime bien quand vous dites que l’approche à avoir ne doit pas trop se limiter à soi-même, et j’ajouterais à son groupe, mais ouvrir rapidement sur le contexte et aussi référer à l’histoire. Je prendrai exemple sur la lutte citoyenne actuelle dans notre quartier du Centre-Sud que la ville veut intégrer de force dans le centre-ville alors que nous affirmons haut et fort que nous sommes voisins du centre-ville, à l’époque de la Nouvelle-France on aurait dit les faubourgs hors des palissades du VIeux-Montréal, et la même ville qui offre notre quartier aux développeurs sur un plateau d’argent. Le rapport de force et la force du nombre n’étant pas en ce moment en notre faveur, tout en nous opposant nous devons ouvrir le dialogue même avec les ’’ méchants promoteurs ’’ et obtenir des gains citoyens et mettre de la pression pour que l’arrondissement et nos élus,es arbitrent la game. Nous allons encore plus loin en ne nous contentant pas de réagir mais en mettant sur la table des projets citoyens comme une plage sur le site du club nautique actuel et un projet commercial-communautaire pour la Place Frontenac.
Voilà ce que m’inspire votre texte dans un premier temps.
Au plaisir
2. De quelques réflexions autour de la confession de Jonathan Folco, 6 novembre 2020, 20:39, par Jean-Yves Bernard
Très bon article qui replace ces questions que chacun se pose dans la perspective globale de notre appartenance à la société.
3. De quelques réflexions autour de la confession de Jonathan Folco, 6 novembre 2020, 20:47
Bonjour Pierre,
Voilà, je partage largement ta perspective vis à vis la lettre de JonathanDF que j’ai lu.
Je voudrais bien me joindre à l’utopie de Jonathan DF mais pas sur la base de la culpabilisation. Et lorsqu’il écrit je préfère me retrousser les manches et me joindre aux personnes qui nous proposent une corvée collective pour faire le ménage dans la maison commune, afin de la rendre belle et accueillante pour tout le monde. j’ai nettement l’impression que la stratégie de cette gauche radicale ne nous offre pas cette invitation, ne nous propose pas cette corvée collective dont nous parle Jonathan et qu’en fait il n’y a pas de maison commune.
Merci Pierre d’apporter cette vision critique et ouverte.
Un message, un commentaire ?